|
COUPABLE DE CROISADE
La croisade contre
les albigeois 1208 - 1243
11 - La deuxième croisade
Il y a probablement
eu à ce moment une lutte d'influence au sein de l'Eglise Catholique
entre les partisans des languedociens et ceux du roi de France.
Mais, les pro-occitans partaient avec plusieurs longueurs de retard
: tous les évêques du midi étaient depuis longtemps ligués contre
les  cathares
et leurs "souteneurs", et il n'y avait aucune raison pour qu'ils
changent d'avis. Malgré les demandes réitérées de Raimond VII pour
obtenir officiellement son héritage et ses titres lors de concile
de Bourges en 1225, l'Eglise va attribuer d'office la totalité des
domaines de Raimond VII au légataire de Amaury de Montfort, Louis
VIII, roi de France. De plus, devant la position du comte de Toulouse
officieux et de ses alliés, le pape Honorius III déclare une nouvelle
croisade contre les barons occitans. cathares
et leurs "souteneurs", et il n'y avait aucune raison pour qu'ils
changent d'avis. Malgré les demandes réitérées de Raimond VII pour
obtenir officiellement son héritage et ses titres lors de concile
de Bourges en 1225, l'Eglise va attribuer d'office la totalité des
domaines de Raimond VII au légataire de Amaury de Montfort, Louis
VIII, roi de France. De plus, devant la position du comte de Toulouse
officieux et de ses alliés, le pape Honorius III déclare une nouvelle
croisade contre les barons occitans.
Louis VIII n'en attend pas moins, et se croise aussitôt. Il part
pour le midi en 1226. En Languedoc, la nouvelle fait l'effet d'un
coup de tonnerre : une nouvelle croisade, et avec le roi de France
! Dans les mémoires, on garde le souvenir du massacre de Béziers,
mais aussi celui de Marmande perpétré par le même prince qui revient
à la tête de son armée ! A l'annonce de son arrivée, nombreux sont
les petits seigneurs qui se soumettent au sénéchal du Roi. Pourtant,
certaines villes résistent : c'est le cas d'Avignon, qui va être
assiégée pendant trois mois, un siège terrible qui s'achèvera par
la soumission de la ville. Louis VIII installe à Carcassonne son
sénéchal Imbert de Beaujeu, mais évite Toulouse contre qui il s'est
déjà cassé les dents. Toutes les autres villes capitulent et les
seigneurs occitans se voient isolés de plus en plus. Raimond VII
est bloqué dans Toulouse et l'armée royale pratique la stratégie
de la terre brûlée. Pourtant, Louis VIII n'aura pas l'occasion de
voir les résultats de la politique de son père et de la sienne,
car il meurt sur le chemin de retour vers Paris, à Montpensier,
en 1226. Sa veuve, Blanche de Castille, prend la régence en attendant
l'arrivée sur le trône de l'héritier Louis IX, le futur Saint Louis,
qui n'a que 11 ans. Une fois de plus, l'héritage politique de Philippe
Auguste se trouve entre de bonnes mains. C'est à se demander d'ailleurs
si Blanche de Castille n'a pas été la réelle souveraine même du
temps de son mari Louis VIII, car la régente garde la même position
vis-à-vis du midi : elle attend que Raimond VII, dernier comte occitan
d'envergure, ne soit plus en position de résister. Et il ne l'est
plus. Ses derniers alliés le lâchent : le roi Jacques Ier d'Aragon,
successeur de Pierre II, se range du coté de l'Eglise. Le roi d'Angleterre,
Henry III, en situation difficile chez lui, n'a guère l'occasion
d'attaquer le roi de France à cette époque. De plus, L'Eglise va
encore enfoncer le clou, en excommuniant Raimond VII en 1227, par
la voix de Pierre Amiel, nouvel archevêque de Narbonne.
Raimond VII résistera encore trois ans. Mais en 1229, il se trouve
dans une position intenable. Il décide donc d'accéder aux exigences
de l'Eglise Catholique et de se soumettre au roi de France. Il se
rend à Paris en pèlerin, fait une déclaration publique de repentir
et signe le traité de Paris avec la régente Blanche de Castille.
Par ce traité, Raimond VII s'engage à détruire l'hérésie, à rendre
à l'Eglise ses biens confisqués, et surtout à marier sa fille Jeanne,
seule héritière du nom, au frère du roi, Alphonse de Poitiers. Si
Alphonse meurt sans descendance, le titre et les fiefs seront directement
rattachés au domaine royal. En attendant, Raimond VII conserve son
titre de comte de Toulouse, mais il est sous le contrôle direct
du sénéchal du roi, prêt à intervenir en cas de manquement à l'engagement
pris. Le comté de Toulouse vit ses dernières heures sous l'autorité
de la descendance de Raimond de Saint-Gilles. Pourtant, si les comtes
occitans sont sous l'autorité du roi de France, le comte de Toulouse
comme le comte de Foix, la foi cathare est loin d'avoir été réduite.
La guerre du pouvoir est finie, la lutte religieuse continue...
Page
suivante
|

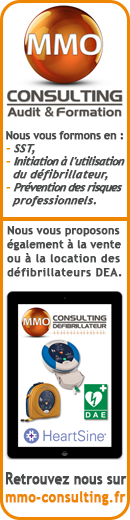
 cathares
et leurs "souteneurs", et il n'y avait aucune raison pour qu'ils
changent d'avis. Malgré les demandes réitérées de Raimond VII pour
obtenir officiellement son héritage et ses titres lors de concile
de Bourges en 1225, l'Eglise va attribuer d'office la totalité des
domaines de Raimond VII au légataire de Amaury de Montfort, Louis
VIII, roi de France. De plus, devant la position du comte de Toulouse
officieux et de ses alliés, le pape Honorius III déclare une nouvelle
croisade contre les barons occitans.
cathares
et leurs "souteneurs", et il n'y avait aucune raison pour qu'ils
changent d'avis. Malgré les demandes réitérées de Raimond VII pour
obtenir officiellement son héritage et ses titres lors de concile
de Bourges en 1225, l'Eglise va attribuer d'office la totalité des
domaines de Raimond VII au légataire de Amaury de Montfort, Louis
VIII, roi de France. De plus, devant la position du comte de Toulouse
officieux et de ses alliés, le pape Honorius III déclare une nouvelle
croisade contre les barons occitans.
