|
Description du château
 Le
château occupe un vaste promontoire au confluent de la Crûme
et de la Sèvre nantaise; une enceinte ovalaire de plus de
300 m de grand diamètre, flanquée de tours ruinées
pour l'essentiel, l'encercle. A l'Est, du côté arrondi
dominant la Sèvre, existait jusqu'en 1958 une motte entourée
de fossés qui fut peut-être le premier noyau castral.
A proximité demeurent les restes de la chapelle castrale,
dont la crypte superbe à trois nefs reposant sur des piliers
circulaires remonte au XIe siècle. Le
château occupe un vaste promontoire au confluent de la Crûme
et de la Sèvre nantaise; une enceinte ovalaire de plus de
300 m de grand diamètre, flanquée de tours ruinées
pour l'essentiel, l'encercle. A l'Est, du côté arrondi
dominant la Sèvre, existait jusqu'en 1958 une motte entourée
de fossés qui fut peut-être le premier noyau castral.
A proximité demeurent les restes de la chapelle castrale,
dont la crypte superbe à trois nefs reposant sur des piliers
circulaires remonte au XIe siècle.
La motte fut remplacée au XIIe siècle par une tour
maîtresse rectangulaire à contreforts arrondis, caractéristiques
de la région. Dominant le fossé barrant le promontoire,
elle contrôlait l'unique entrée ménagée
dans une tour-porte qui lui est accolée. Cette tour forme
encore l'accès actuel; mais le voûtement de la porte
a été repris à l'époque moderne, tout
en conservant la baie romane placée au-dessus. Dans la seconde
moitié du XIIe siècle fut élevée la
chapelle haute, dont demeurent quelques ruines en élévation,
chevet circulaire et croisée du transept aux piliers flanqués
de colonnes à chapiteaux romans.
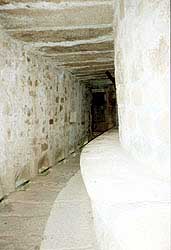 Sans
doute les vicomtes de Thouars renforcèrent-ils également,
à cette époque, l'enceinte par des tours de flanquement;
on reconnaît en parcourant celle-ci des tours semi-circulaires
de petites dimensions, bien dans les usages de l'architecture Plantagenêt,
attribuables à la fin du XIIe siècle. Sans
doute les vicomtes de Thouars renforcèrent-ils également,
à cette époque, l'enceinte par des tours de flanquement;
on reconnaît en parcourant celle-ci des tours semi-circulaires
de petites dimensions, bien dans les usages de l'architecture Plantagenêt,
attribuables à la fin du XIIe siècle.
À partir du XVe siècle l'ensemble fit l'objet de remaniements
considérables, pour adapter le château aux armes à
feu. La tour-porte primitive fut prolongée par un vaste boulevard
allongé, pourvu de deux tours en capitale, accueillant l'entrée
avancée, à la perpendiculaire de l'axe primitif comme
de coutume; il en demeure la face 0. Le front de l'entrée
lui-même fut entièrement restructuré, de nouvelles
tours de flanquement y furent ajoutées; et la tour maîtresse
fut entourée d'une chemise pourvue d'un fossé propre
et d'une tour-porte d'accès vers l'intérieur du château.
 La
création de ce réduit peut être attribuée
à Gilles de Rais lui-même, peu de temps après
sa prise de possession du château en 1420 : de belles archères-canonnières
à orifice et fente disjoints en attestent. La
création de ce réduit peut être attribuée
à Gilles de Rais lui-même, peu de temps après
sa prise de possession du château en 1420 : de belles archères-canonnières
à orifice et fente disjoints en attestent.
Le reste de l'enceinte fut également renforcé, surtout
à la pointe Nord, où fut établie une digue
massive pour retenir les eaux de la Crûme. De ce côté
furent bâties deux superbes tours à canon reliées
par une courtine au fruit prononcé abritant une galerie de
contremine. La tour du Vidame, traditionnellement attribuée
à Louis de Vendôme vers 1520, ce qui paraît assez
tardif, devrait dater comme sa voisine des années 1490-1500;
toutes deux sont pourvues de canonnières à la française,
la première d'une belle ceinture de mâchicoulis où
les guides aiment à faire jouer les effets sonores. Le noyau
de la vis était évidé et servait de porte-voix.
Texte extrait du
livre de Jean Mesqui Chateaux
forts et fortifications
|


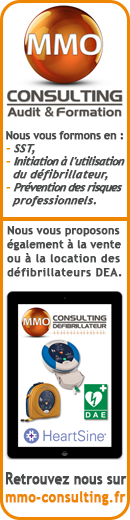
 Le
château occupe un vaste promontoire au confluent de la Crûme
et de la Sèvre nantaise; une enceinte ovalaire de plus de
300 m de grand diamètre, flanquée de tours ruinées
pour l'essentiel, l'encercle. A l'Est, du côté arrondi
dominant la Sèvre, existait jusqu'en 1958 une motte entourée
de fossés qui fut peut-être le premier noyau castral.
A proximité demeurent les restes de la chapelle castrale,
dont la crypte superbe à trois nefs reposant sur des piliers
circulaires remonte au XIe siècle.
Le
château occupe un vaste promontoire au confluent de la Crûme
et de la Sèvre nantaise; une enceinte ovalaire de plus de
300 m de grand diamètre, flanquée de tours ruinées
pour l'essentiel, l'encercle. A l'Est, du côté arrondi
dominant la Sèvre, existait jusqu'en 1958 une motte entourée
de fossés qui fut peut-être le premier noyau castral.
A proximité demeurent les restes de la chapelle castrale,
dont la crypte superbe à trois nefs reposant sur des piliers
circulaires remonte au XIe siècle.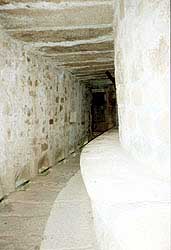 Sans
doute les vicomtes de Thouars renforcèrent-ils également,
à cette époque, l'enceinte par des tours de flanquement;
on reconnaît en parcourant celle-ci des tours semi-circulaires
de petites dimensions, bien dans les usages de l'architecture Plantagenêt,
attribuables à la fin du XIIe siècle.
Sans
doute les vicomtes de Thouars renforcèrent-ils également,
à cette époque, l'enceinte par des tours de flanquement;
on reconnaît en parcourant celle-ci des tours semi-circulaires
de petites dimensions, bien dans les usages de l'architecture Plantagenêt,
attribuables à la fin du XIIe siècle. La
création de ce réduit peut être attribuée
à Gilles de Rais lui-même, peu de temps après
sa prise de possession du château en 1420 : de belles archères-canonnières
à orifice et fente disjoints en attestent.
La
création de ce réduit peut être attribuée
à Gilles de Rais lui-même, peu de temps après
sa prise de possession du château en 1420 : de belles archères-canonnières
à orifice et fente disjoints en attestent.
