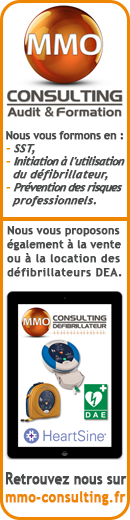Côtes
d'Armor |
|
|
Finistère |
-
Trémazan
|
Ille
et Vilaine |
-
Bonne-Fontaine
- Châteaugiron - Combourg - Fougères - Hédé - Landal - Montmuran - Saint Aubin - Vitré |
Morbihan |
|
|
Les
autres régions et autres châteaux |
- Les Autres régions
- Châteaux Renaissance
- Châteaux Classique
- Châteaux Cathares
- Châteaux d'Europe
Les sélections
des mois précédents |
| Château de Fougères | |
|
3a - Le XVe siècle A nouveau, le château
de fougères va connaître le fond du malheur. Raoul II le valeureux
était jadis le recours, le défenseur de la cité. Aujourd'hui, les
Alençon sont loin. Jean d'Alençon 1er du nom, a été tué à Azincourt,
et Jean, second du nom, a été fait prisonnier à Verneuil. Des bandes
mettent la région fougeraise à sac. La ville, plus ou moins livrée
à elle-même, se tourne vers le duc de Bretagne. D'ailleurs, c'est
au duc que Jean II d'Alençon vend la château de Fougères pour payer
sa rançon aux Anglais, en 1428. La place fortifiée va-t-elle retrouver
son rôle de citadelle avancée? Il lui manque décidément un chef,
une âme, comme on va le voir en 1449. 3b - Le XVIe siècle Pourtant, Fougères
a un nom. Sa grandeur passée et ses fières murailles en font un
apanage de choix. Aussi retient-elle l'attention de la faveur royale
qui l'octroie d'abord à un valeureux capitaine qui s'est illustré
à Pavie. Puis, de 1547 à 1566, elle échoit à la favorite d'Henri
II, la belle Diane de Poitiers. Ainsi parvient de la lointaine Italie
et de la cour de France l'esprit nouveau de la Renaissance, qui
est l'art de vivre. Page suivante 1 - 2 - 3 - 4 Page précédente |
|
Le château du mois |
Recherchez sur le site |
Pour toute question concernant ce site web, envoyez un message au webmaster