|
L'histoire du château
Moncontour, place-forte
de Penthièvre.
 Une
fois la situation stabilisée, les architectes de Clisson
pansent les plaies de leurs places et, si les travaux reprennent,
de nouvelles directives sont données. Les progrès
de la poliorcétique avec le développement de l'artillerie
peu avant 1400 modifient progressivement mais considérablement
les concepts d'architecture militaire et imposent désormais
des réalisations différentes. Les guerres ont révélé
la nécessité de conserver des espaces libres entre
le rempart et les constructions, souvent privées, édifiées
anarchiquement lors des périodes de paix. On a ainsi recours
à certaines expropriations, telle celle d'une femme dépossédée
de son terrain afin de permettre l'aménagement de jardins.
Surtout, la nécessité de rendre les remparts résistants
aux pilonnages de l'artillerie donne naissance à un nouveau
type de rempart, moins élevé et plus épais.
Les vieilles murailles sont écrêtées vers l'intérieur
où des remblais viennent renforcer leur résistance
sur une hauteur maximale. Ces " remparements " bouleversent
parfois la conception interne de la place en condamnant certaines
zones urbanisées et certaines issues vers l'extérieur.
C'est probablement ce remparement des murailles Nord-Est de la ville
qui provoque la condamnation de l'issue par la porte ogivale donnant
sur le Point-du-Jour, enfouie désormais sous plusieurs mètres
de remblais. Une
fois la situation stabilisée, les architectes de Clisson
pansent les plaies de leurs places et, si les travaux reprennent,
de nouvelles directives sont données. Les progrès
de la poliorcétique avec le développement de l'artillerie
peu avant 1400 modifient progressivement mais considérablement
les concepts d'architecture militaire et imposent désormais
des réalisations différentes. Les guerres ont révélé
la nécessité de conserver des espaces libres entre
le rempart et les constructions, souvent privées, édifiées
anarchiquement lors des périodes de paix. On a ainsi recours
à certaines expropriations, telle celle d'une femme dépossédée
de son terrain afin de permettre l'aménagement de jardins.
Surtout, la nécessité de rendre les remparts résistants
aux pilonnages de l'artillerie donne naissance à un nouveau
type de rempart, moins élevé et plus épais.
Les vieilles murailles sont écrêtées vers l'intérieur
où des remblais viennent renforcer leur résistance
sur une hauteur maximale. Ces " remparements " bouleversent
parfois la conception interne de la place en condamnant certaines
zones urbanisées et certaines issues vers l'extérieur.
C'est probablement ce remparement des murailles Nord-Est de la ville
qui provoque la condamnation de l'issue par la porte ogivale donnant
sur le Point-du-Jour, enfouie désormais sous plusieurs mètres
de remblais.
A cette époque également, le tracé du rempart
primitif au Nord est abandonné. Le nouveau rempart est porté
au-delà du massif rocheux. De nouvelles tours, davantage
espacées les unes des autres, sont édifiées
en forte saillie sur la courtine, à l'intérieur desquelles
des espaces aménagés dans l'épaisseur des murs
permettent la mise en place de couleuvrines qui renforcent considérablement
la protection des courtines ; les " pertus " de canonnière
apparaissent désormais sur les fortifications, se substituant
aux archères sur les anciennes tours, et l'on n'hésite
d'ailleurs pas à aménager davantage de canonnières
que l'on ne possède réellement de canons car, si toutes
ne sont pas armées, du moins l'assaillant pourra-t-il en
douter et pourra-t-on le faire le cas échéant. L'utilisation
généralisée de l'artillerie révèle
encore la fragilité des angles droits, imposant la prépondérance
du plan circulaire ou apparenté puis des angles brisés.
L'édification de la tour du Moinet, seul modèle de
tour à canon à Moncontour, complète le dispositif
du nouveau rempart. Au début du XVe siècle, les tensions
entre le parti de Penthièvre et l'administration ducale imposent
le maintien des ateliers qui perfectionnent encore le dispositif
défensif de la ville après son entrée dans
le domaine ducal en 1410 qui lui vaut par ailleurs d'être
épargnée par les programmes de démilitarisation
de 1420.
Les archives du XVe siècle ne mentionnant aucune véritable
construction, hormis celle de la tour Mognet et celle de la demi-lune
de la porte d'En-Haut, la ville possède à cette époque
la forme qu'elle conservera à travers les siècles
suivants. Jusqu'à la fin du XVe siècle, l'absence
de conflit sur le sol breton profite à l'économie
qui procure aux villes castrales les moyens financiers nécessaires
à l'exécution des gros travaux. Dans le budget global
de Moncontour, ceux-ci représentent alors plus des trois
quarts des dépenses alors qu'une faible partie est destinée
à l'artillerie, le reste (un cinquième) assurant à
hauteur égale les gages, les rabats de fermes et des dépenses
diverses comme l'indemnisation des victimes.
 Place-forte
ducale, Moncontour est particulièrement visée dans
le conflit opposant pour la première fois la Bretagne à
un ennemi extérieur, le royaume de France dont les volontés
expansionnistes s'affichent au lendemain du départ des anglais
du sol continental auquel les bretons ont d'ailleurs largement contribué.
Dans le dernier quart du XVe siècle, les souverains français
s'acharnent contre leurs " vassaux " et l'isolement du
duché par rapport à son allié bourguignon leur
permet d'y effectuer une série de trois campagnes peu glorieuses,
du moins victorieuses. Au cours de l'agression française
(1487-1489), la ville fait comme toutes les autres places-fortes
de Bretagne l'objet des enjeux d'un parti et de l'autre. Place-forte
ducale, Moncontour est particulièrement visée dans
le conflit opposant pour la première fois la Bretagne à
un ennemi extérieur, le royaume de France dont les volontés
expansionnistes s'affichent au lendemain du départ des anglais
du sol continental auquel les bretons ont d'ailleurs largement contribué.
Dans le dernier quart du XVe siècle, les souverains français
s'acharnent contre leurs " vassaux " et l'isolement du
duché par rapport à son allié bourguignon leur
permet d'y effectuer une série de trois campagnes peu glorieuses,
du moins victorieuses. Au cours de l'agression française
(1487-1489), la ville fait comme toutes les autres places-fortes
de Bretagne l'objet des enjeux d'un parti et de l'autre.
La première campagne (1487) donne lieu à trois attaques
dont deux dès le mois de juin. Au cours de ce mois en effet,
Pierre de Rohan, commandant pour le parti français, aborde
le Penthièvre et, profitant de l'absence de Roland Gouicquet,
capitaine de Moncontour pour François II, attaque la ville
qu'il investit avec une facilité étonnante. Certes,
l'armée française est mieux organisée et mieux
armée aussi que l'armée bretonne ; celle-ci au contraire
n'est pas préparée à de tels combats et surtout,
plus que tout même, l'autorité ducale se disloque en
plein conflit, minée par la corruption et les trahisons secrètement
introduites et encouragées par la France depuis plusieurs
années. Toutefois, la contre-attaque ne tarde pas. Les français
à peine installés dans la cité y sont à
leur tour assiégés dès le 24 juin lorsque,
venant de Quintin, Jehan de Coëtmen se présente avec
5.000 hommes devant Moncontour et pose le siège pour plusieurs
jours. Périodiquement, les canons de l'armée ducale
battent les points stratégiques des fortifications et à
plusieurs reprises, après qu'un pilonnage intensif a momentanément
bouleversé la défense française, ses troupes
se lancent à l'assaut de la place avant d'être finalement
repoussées. Au terme de plusieurs tentatives infructueuses,
et ne pouvant laisser davantage Nantes à la portée
des français, Coëtmen décide d'abandonner le
siège de Moncontour pour ramener ses troupes auprès
de la capitale bretonne. Le siège est levé le 5 juillet.
Mettant à profit la décomposition de l'armée
française le mois suivant, François Tournemine surprend
Moncontour qu'il parvient à investir, sans que l'on ait davantage
d'informations sur la manière dont cette (re)prise s'est
déroulée. Quoiqu'il en soit, la ville devient une
base importante pour les troupes ducales dans l'évêché
de Saint-Brieuc où sont rassemblés troupes, armes,
munitions et ravitaillement qui lui permettent de demeurer en possession
du parti ducal jusqu'à la troisième campagne.
La campagne fulgurante de douze mille soldats franco-bretons à
travers le duché en janvier 1489 voit ceux-ci, venant de
Montfort, se présenter le 17 devant Moncontour dont Gouicquet
est une nouvelle fois absent. Les pièces d'artillerie emmenées
de Saint-Malo sont mises à contribution pour battre le rempart
et la garnison en place, désemparée, isolée
et incapable de résister davantage à un assaillant
démesuré, ne peut qu'abandonner toute résistance.
La ville n'est restituée au parti breton qu'avec la reddition
du duc.
Aussitôt Moncontour est pressentie par l'administration ducale
pour des projets de cantonnement de troupes alliées, tous
avortés, témoignant néanmoins de l'intérêt
de sa situation. Cédée par Anne au Prince d'Orange,
la place connaît en cette fin de XVe siècle une importante
campagne de restauration dont la responsabilité est confiée
à Gilles de Kermené et nécessitant la mise
en place d'une fiscalité particulière. Les comptes
de Jehan de Bréhand révèlent que l'on assiste
à l'augmentation considérable de la diversification
des allocations budgétaires au détriment des gros
travaux qui ne représentent plus que 47% des dépenses
; l'artillerie représente en effet 12,5%, les gages 3,5%,
les rabats de fermes 2,5% et surtout des frais divers 34,5%.
Page
précédente - Page
suivante
|


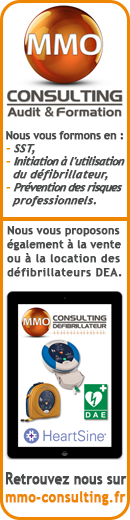
 Une
fois la situation stabilisée, les architectes de Clisson
pansent les plaies de leurs places et, si les travaux reprennent,
de nouvelles directives sont données. Les progrès
de la poliorcétique avec le développement de l'artillerie
peu avant 1400 modifient progressivement mais considérablement
les concepts d'architecture militaire et imposent désormais
des réalisations différentes. Les guerres ont révélé
la nécessité de conserver des espaces libres entre
le rempart et les constructions, souvent privées, édifiées
anarchiquement lors des périodes de paix. On a ainsi recours
à certaines expropriations, telle celle d'une femme dépossédée
de son terrain afin de permettre l'aménagement de jardins.
Surtout, la nécessité de rendre les remparts résistants
aux pilonnages de l'artillerie donne naissance à un nouveau
type de rempart, moins élevé et plus épais.
Les vieilles murailles sont écrêtées vers l'intérieur
où des remblais viennent renforcer leur résistance
sur une hauteur maximale. Ces " remparements " bouleversent
parfois la conception interne de la place en condamnant certaines
zones urbanisées et certaines issues vers l'extérieur.
C'est probablement ce remparement des murailles Nord-Est de la ville
qui provoque la condamnation de l'issue par la porte ogivale donnant
sur le Point-du-Jour, enfouie désormais sous plusieurs mètres
de remblais.
Une
fois la situation stabilisée, les architectes de Clisson
pansent les plaies de leurs places et, si les travaux reprennent,
de nouvelles directives sont données. Les progrès
de la poliorcétique avec le développement de l'artillerie
peu avant 1400 modifient progressivement mais considérablement
les concepts d'architecture militaire et imposent désormais
des réalisations différentes. Les guerres ont révélé
la nécessité de conserver des espaces libres entre
le rempart et les constructions, souvent privées, édifiées
anarchiquement lors des périodes de paix. On a ainsi recours
à certaines expropriations, telle celle d'une femme dépossédée
de son terrain afin de permettre l'aménagement de jardins.
Surtout, la nécessité de rendre les remparts résistants
aux pilonnages de l'artillerie donne naissance à un nouveau
type de rempart, moins élevé et plus épais.
Les vieilles murailles sont écrêtées vers l'intérieur
où des remblais viennent renforcer leur résistance
sur une hauteur maximale. Ces " remparements " bouleversent
parfois la conception interne de la place en condamnant certaines
zones urbanisées et certaines issues vers l'extérieur.
C'est probablement ce remparement des murailles Nord-Est de la ville
qui provoque la condamnation de l'issue par la porte ogivale donnant
sur le Point-du-Jour, enfouie désormais sous plusieurs mètres
de remblais. Place-forte
ducale, Moncontour est particulièrement visée dans
le conflit opposant pour la première fois la Bretagne à
un ennemi extérieur, le royaume de France dont les volontés
expansionnistes s'affichent au lendemain du départ des anglais
du sol continental auquel les bretons ont d'ailleurs largement contribué.
Dans le dernier quart du XVe siècle, les souverains français
s'acharnent contre leurs " vassaux " et l'isolement du
duché par rapport à son allié bourguignon leur
permet d'y effectuer une série de trois campagnes peu glorieuses,
du moins victorieuses. Au cours de l'agression française
(1487-1489), la ville fait comme toutes les autres places-fortes
de Bretagne l'objet des enjeux d'un parti et de l'autre.
Place-forte
ducale, Moncontour est particulièrement visée dans
le conflit opposant pour la première fois la Bretagne à
un ennemi extérieur, le royaume de France dont les volontés
expansionnistes s'affichent au lendemain du départ des anglais
du sol continental auquel les bretons ont d'ailleurs largement contribué.
Dans le dernier quart du XVe siècle, les souverains français
s'acharnent contre leurs " vassaux " et l'isolement du
duché par rapport à son allié bourguignon leur
permet d'y effectuer une série de trois campagnes peu glorieuses,
du moins victorieuses. Au cours de l'agression française
(1487-1489), la ville fait comme toutes les autres places-fortes
de Bretagne l'objet des enjeux d'un parti et de l'autre.
